Les éditions L'Harmattan viennent de publier un essai de Laurent Mélito intitulé Jean-Claude Michéa, entre héritage et contestation - Une anthropologie politique en tension. Laurent Mélito est sociologue d'intervention.
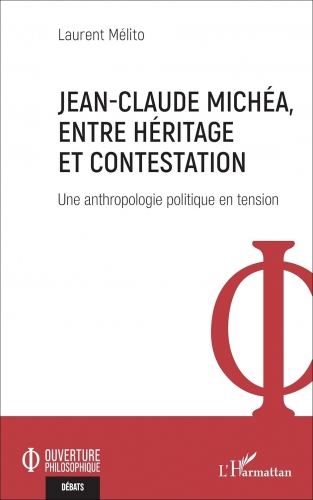
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Les éditions L'Harmattan viennent de publier un essai de Laurent Mélito intitulé Jean-Claude Michéa, entre héritage et contestation - Une anthropologie politique en tension. Laurent Mélito est sociologue d'intervention.
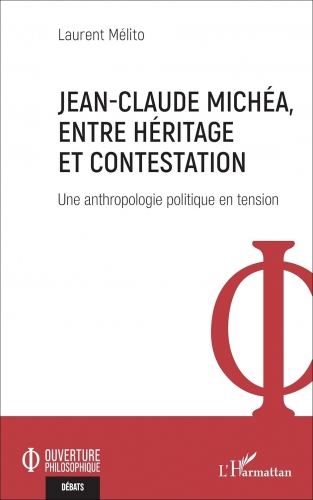
Nous reproduisons ci-dessus un entretien donné par Frédéric Saint-Clair au Figaro Vox dans lequel il évoque son essai, Comment sortir de l'impasse libérale ? - Essai de philosophie politique civilisationnelle (L'Harmattan, 2022).
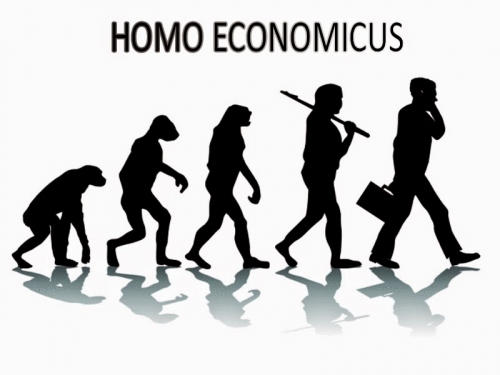
L'homo-œconomicus est-il le seul avenir de l'homme ?
FIGAROVOX. - Vous publiez « Comment sortir de l'impasse libérale ? », aux éditions L'Harmattan. Selon vous, est-ce la fin de la « fin de l'histoire » ?
Frédéric SAINT-CLAIR. - Le concept de « fin de l'Histoire » est un héritage de la philosophie allemande qui a connu un regain d'intérêt au début des années 90, lors de l'effondrement du régime soviétique, grâce à la publication du désormais célèbre ouvrage de Francis Fukuyama qui annonçait une telle fin de l'Histoire, c'est-à-dire le fait d'avoir atteint un modèle politique et économique indépassable : la démocratie libérale. Sauf que le choc des civilisations, théorisé à la même époque par Samuel Huntington et inscrit dans les faits depuis, est venu bousculer les certitudes des Occidentaux, de même que la résurgence des modèles politiques illibéraux, tel celui de Viktor Orbán au cœur de l'Europe, qui semble mieux résister à la violence des chocs civilisationnels que le nôtre, et surtout l'incroyable essor des modèles capitalistes autoritaires, comme en Chine, qui est le véritable gagnant de la mondialisation. Trente ans après, l'Occident est déclassé, l'hyperpuissance américaine n'est qu'un lointain souvenir, l'Europe est au bord de la désintégration, quoi qu'en disent ses thuriféraires, et la France des métropoles ressemble à s'y méprendre à un pays du tiers-monde. Donc, pour répondre à votre question, non, ce n'est pas la fin de l'Histoire, non le modèle libéral n'est pas un must indépassable. Mais, dire cela, c'est ne rien dire, car tout le monde s'en était rendu compte. La question qui m'a occupé dans ce livre a été : une fois ce constat d'échec posé, que fait-on ?
La réponse a consisté, dans un premier temps, à opérer une relecture de l'ouvrage de Francis Fukuyama, « La fin de l'Histoire et le dernier Homme ». Pourquoi ? Principalement parce que s'il a été beaucoup critiqué, il a surtout été mal lu ! Disons-le : Fukuyama est absolument brillant, et il a indiqué lui-même qu'il y avait un problème dans son modèle. Ses critiques l'on fait passer pour un néolibéral standard, adepte du capitalisme américain, mais Fukuyama s'inscrit dans la continuité de la philosophie allemande, Kant, Hegel et Nietzsche ; et il est un disciple de Kojève, lequel relit Hegel à travers la dialectique du Maître et de l'Esclave. Qu'est-ce à dire ? Tout d'abord que Fukuyama n'a rien d'un néolib' idéaliste façon « Mozart de la finance », et surtout que le véritable pivot de son argumentaire, et en même temps sa grande faiblesse conceptuelle, ne réside pas dans « la fin de l'Histoire », mais dans « le dernier Homme »… Or, tout le monde est passé à côté ! Interrogeons-nous : à quoi ressemble-t-il, ce « dernier Homme » ? Fukuyama y répond, sans détour : à un bourgeois déraciné, repu, gavé de richesses, qui renonce à la guerre au profit d'une vie toute de consommation. En d'autres termes, il ressemble à un « chien bien nourri ». Le voilà, l'idéal anthropologique des libéraux. Et là, chacun comprendra aisément qu'on a un sérieux problème !
Francis Fukuyama décrivait dans « La Fin de l'histoire et le dernier homme », la contradiction anthropologique du libéralisme : « [Les êtres humains] voudront être des citoyens plutôt que des bourgeois, trouvant la vie d'esclave sans maître – la vie de consommateur rationnelle – en fin de compte lassante. Ils voudront avoir des idéaux au nom de quoi vivre et mourir, même si les plus importants ont été réalisés hic et nunc, et ils voudront aussi risquer leur vie, même si le système international des États a réussi à abolir toute possibilité de guerre ». Cette contradiction a-t-elle été et peut-elle être résolue ?
Vous mettez le doigt sur le sérieux problème, que Hegel, et après lui Marx, nomment « contradiction ». Celle-ci est de nature anthropologique, c'est-à-dire qu'elle concerne l'essence de l'homme. Francis Fukuyama a bien évidemment conscience, au moment où il écrit son ouvrage, que le modèle libéral qu'il défend n'est pas libre de contradictions, car le « dernier Homme » tel qu'il l'envisage ne saurait exister. Quel individu a envie de ressembler aux bourgeois tartuffes illustrés par Daumier, nombrilistes préoccupés uniquement de satisfaire leur bien-être matériel ? L'homo-œconomicus sera empêché de céder à la médiocrité de l'idéal libéral par sa vanité, ou, pour le dire de façon plus philosophique, par son « désir de reconnaissance », ou, pour le dire de façon encore plus philosophique, à la mode platonicienne : par son thymos, et plus particulièrement par sa mégalothymia, sa volonté de puissance.
Posons-nous cette question : pourquoi les sociétés occidentales, au tournant de la Révolution industrielle, renoncent-elles peu à peu au modèle aristocratique de la guerre au profit du modèle bourgeois de l'échange ? Cela a pris plus d'un siècle, et il y a eu des allers-retours (et il y en a encore), mais la dynamique historique est bien celle-là. Pourquoi la production et l'échange plutôt que la guerre et la conquête ? Benjamin Constant y répond ainsi : « La guerre et le commerce ne sont que deux moyens différents d'arriver au même but : celui de posséder ce que l'on désire ». Pour le dire autrement : La richesse est aussi un synonyme de puissance. L'enrichissement est un autre moyen pour un individu (comme pour un État) d'assouvir sa volonté de puissance, d'asseoir son désir de reconnaissance, de satisfaire son thymos, de se distinguer des autres individus (ou de dominer les autres États).
Fukuyama, à la suite d'Alexandre Kojève, a cru que le libéralisme, politique et économique, permettrait de maîtriser, voire d'annihiler, la volonté de puissance des individus comme celle des États, et d'obtenir une société entièrement pacifiée. Le XXIe siècle leur a apporté un cinglant démenti, en consacrant la victoire de Machiavel sur John Locke. Le seul moyen de maîtriser la volonté de puissance, c'est de lui opposer une autre volonté de puissance : thymos contre thymos. Le libéralisme a permis de modifier les formes de la rivalité, entre individus comme entre États, non de mettre un terme à cette rivalité. Tout l'enjeu consiste donc à continuer de faire évoluer les formes de la rivalité mégalothymique afin de nous libérer des contradictions propres au libéralisme, de son incapacité à tenir ses promesses en matière économique et sociale, et de sa propension à détruire la beauté du monde, à brûler la nature et à ruiner les civilisations. En d'autres termes, d'en finir avec le libéralisme…
Ne craignez-vous pas, en en finissant avec le libéralisme, d'en finir avec la liberté ?
Le concept de liberté a existé bien avant l'apparition du libéralisme. Il survivra aisément à sa disparition. D'autant que l'enjeu n'est pas de devenir des illibéraux, mais des post-libéraux, c'est-à-dire de prendre le recul nécessaire pour développer un modèle qui permette d'insérer l'idéal de liberté dans un écrin plus majestueux que celui, en toc, qui nous a été livré par les Lumières anglo-saxonnes : l'accroissement indéfini des droits et de la richesse des individus.
La question est : comment faire ? Certains envisagent de revenir à un concept de liberté plus proche de celui qu'avaient les Anciens, dans l'Antiquité grecque notamment. Je préfère penser que nous sommes Modernes et que nous le resterons ! Le grand coup de génie politique des Modernes réside dans la création de cet espace de liberté incroyable qu'est la « société civile ». Nous devons en repenser les formes politiques afin de la protéger et de lui rendre son intégrité, et sa spécificité occidentale, et nationale.
Notons que ce n'est pas l'État, mais la société civile qui est ciblée, autant par l'Islam civilisationnel que par le capitalisme américain ou chinois ; et le libéralisme facilite leur emprise progressive par l'extension indéfinie, et aveugle, de ces libertés dites « fondamentales ». Rappelons qu'avant la multiplication des hidjabs et du halal, la France a connu la multiplication des jeans, basket et des hamburgers. Le libéralisme, y compris sous sa forme socialisée, a-t-il constitué un rempart efficace face à ces softs powers civilisationnels agressifs ? Absolument pas ! Notre société civile, notre lieu de vie en commun, nos mœurs, nos traditions, notre environnement, ont été américanisés hier, ils sont islamisés aujourd'hui, et ils seront sans nul doute sinisés demain. Les responsables politiques, quels qu'ils soient, se paient de mots lorsqu'ils parlent de protéger notre civilisation. La vérité c'est que leurs modèles politiques de référence sont tous, peu ou prou, rattachés à une forme de social-libéralisme, d'une impuissance totale parce qu'entièrement aveugle au fait civilisationnel.
Face aux deux blocs que sont la Chine et les États-Unis, comment la France peut-elle encore exister en tant que modèle civilisationnel ?
À vrai dire, développer un modèle politique civilisationnel digne de ce nom – c'est-à-dire qui soit autre chose qu'une caricature d'autoritarisme politique allié à un libéralisme économique déguisé – est le seul moyen d'exister face à la Chine et aux États-Unis. Qui peut croire sérieusement que le modèle libéral mondialisé nous permettra de rendre à la France sa puissance et de rivaliser avec la Chine ou les USA ? Qui peut croire qu'une dose de protectionnisme économique nous permettra de sauver notre économie, de revitaliser nos territoires, de redorer notre patrimoine ? C'est une véritable révolution intellectuelle et politique qui est attendue si nous voulons éviter d'être fossilisés.
Nous avons progressé cependant, il convient de le noter, car nous posons désormais collectivement – gauche radicale exceptée – le constat de la menace qui pèse sur notre héritage civilisationnel. Le fait d'avoir renoncé au terme « identité nationale » au profit du terme « civilisation » est une première victoire qui reflète une prise de conscience culturelle salutaire. Mais c'est insuffisant. Car, nous nous soumettons encore, sans l'avouer, à l'éternel modèle économique et politique libéral. En gros, nous moquons publiquement la « fin de l'Histoire » de Fukuyama, nous nous rions ouvertement de la prétendue victoire des démocraties libérales, mais intérieurement, nous y souscrivons pleinement, et nos réflexes intellectuels, politiques, et même électoraux, en témoignent. Nous nous comportons comme si le libéralisme avait réellement gagné. Nous sommes intellectuellement restés bloqués au XXe siècle, prisonniers de concepts tels que : démocratie, croissance, réduction des inégalités, protection des libertés individuelles, Laïcité, Innovation, Défis technologiques, réduction de la dette… Rien de tout cela ne nous permettra de résister face aux géants de demain, car ces concepts relèvent d'un même et unique paradigme : le libéralisme. Or, celui-ci est dans l'impasse. Il n'a pas gagné ! Faut-il le répéter ? Lisez Kishore Mahbubani ! Demain, la Chine gagnera.
L'unique solution consiste à changer de paradigme. Le paradigme civilisationnel n'est pas seulement une bizarrerie d'intellectuel, c'est un moyen de rendre à l'Occident son influx. Cela suppose de transformer notre conception de la puissance. Pour le dire vite : neutraliser les ferments de la conquête comme ceux de la concurrence. Pour y parvenir, il nous faut plonger au cœur du libéralisme, et principalement du libéralisme économique, pour exhumer ce qui pourrait permettre de le dépasser, la fameuse contradiction non résolue, la faiblesse du « dernier Homme ». Kojève nous offre la solution. Il a, en effet, abandonné son idéal du dernier Homme libéral lors d'un voyage au Japon, en 1958, lorsqu'il a découvert les merveilles de la civilisation japonaise et son idéal de beauté, au travers du théâtre Nô, de la cérémonie du thé, de la composition florale…
Vous en appelez à une esthétisation du monde… La beauté peut-elle sauver notre civilisation ?
Elle seule peut le faire, aussi étonnant que puisse paraître cette réponse. La beauté est, dans sa dimension politique, le grand impensé de notre époque. Même Simone Weil, lorsqu'elle égrène la longue liste des besoins de l'âme : ordre, liberté, obéissance, responsabilité, etc., n'en dit pas un mot. Se pourrait-il que l'âme puisse se dispenser de beauté ? Bien évidemment pas, mais la considérer sous sa forme politique est un défi – sauf à l'ancrer dans une conception civilisationnelle du politique.
La beauté occupe dans le paradigme civilisationnel la place de la morale dans le paradigme libéral. Car, en effet, de Jean-Claude Michéa, adepte de la common decency orwellienne, à Amartya Sen, prix Nobel d'économie, la moralisation de l'économie semble être l'unique réponse à notre mal-être libéral. Le hic ? La morale est impuissante à prendre en charge les attentes du thymos, elle est incapable de dompter la mégalothymia visible dans le processus d'accumulation indéfinie de capital.
La beauté peut y parvenir, en revanche. Pourquoi ? Parce qu'elle se trouve au cœur de la mécanique d'acquisition des richesses, au cœur de la mécanique capitaliste. Il faut lire l'ouvrage de Lipovetsky et Serroy, « L'esthétisation du monde », lesquels décrivent cela très bien – sans pour autant en tirer les conséquences qu'on pourrait attendre, de façon étonnante… Pour le dire de façon imagée : ce ne sont pas les vertus des aristocrates qui sidéraient le peuple naguère, mais le faste de leurs vêtements et de leurs palais. C'est aussi la beauté de notre patrimoine, naturel et culturel, qui attire chaque année des millions de touristes. Car la beauté est, comme la richesse, synonyme de puissance. Dans tout ce que nous achetons, nous visons la beauté : nos vêtements, nos meubles, nos voitures, jusqu'à la brosse qui sert à nettoyer nos WC. Tout passe entre les mains des designers, sans lesquels rien n'est aujourd'hui commercialisable.
Rendre à la beauté la place qui lui est due politiquement aura une conséquence immédiate : faire descendre l'homo-œconomicus libéral de son piédestal, et y faire monter à sa place l'homo-æsthéticus. Notons que cet homo-æsthéticus n'est pas une création d'intellectuel. Il a existé très largement en Europe, dans ce qui a été le berceau de la Modernité : l'Italie de la Renaissance. Il revêtait à l'époque le visage de l'humaniste lettré, avant d'endosser l'habit de l'aristocrate durant le Grand Siècle français, initiateur du « paradigme des manières » cher à Montesquieu, dans des salons où le rôle des femmes était central tant féminité et civilisation sont inséparables. Il n'est nulle part mieux décrit que dans l'ouvrage de Baldassar Castiglione, « Il Cortegiano », qui surpassait largement le bourgeois urbain contemporain par… sa grâce. De cette grâce qui est venue aux hommes, dit-on, par le Christ, et qui n'est pas seulement synonyme de beauté – Alain Pons nous expliquant qu'elle est aussi « l'acte par lequel on s'attire de la reconnaissance ». Revoilà donc le thymos, dès la Renaissance italienne, pris en charge d'une manière qui n'a rien à envier au libéralisme tant l'humanisme a su créer les merveilles de notre civilisation que le libéralisme n'a de cesse de ruiner.
Frédéric Saint-Clair, propos recueillis par Alize Le Corre (Figaro Vox, 6 janvier 2022)
Les éditions Pardès viennent de publier dans leur collection Qui suis-je ? un George Orwell, signé par Thomas Renaud. Journaliste et critique littéraire, Thomas Renaud, qui collabore à plusieurs de titres de presse, est déjà l'auteur, dans la même collection, d'un Georges Bernanos (Pardès, 2018).

" Né le 25 juin 1903 à Motihari (Inde), George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, fut un infatigable militant. Socialiste authentique, il n'hésita pas à rompre avec la gauche officielle de son temps, aveuglée par sa fascination stalinienne. Son souci de la vie digne lui rendait tout aussi suspect un progressisme hors-sol, et il n'hésita pas à se définir lui-même comme un anarchiste tory. Des tranchées de Catalogne jusqu'aux bombardements de la capitale anglaise, il ne renonça jamais à prendre parti dans un monde en décomposition. Orwell fut surtout un contempteur acharné du totalitarisme. Ses deux plus grands succès, 1984 et La Ferme des animaux, sont là pour en témoigner. La tentation totalitaire était la grande question du siècle dernier, mais elle perdure dans le nôtre, considérablement amplifiée par le pouvoir immense qu’offre l'emprise numérique aux mains des tyrans de notre époque. Toutefois, si ces deux romans antitotalitaires méritent, plus que jamais et de toute urgence, d'être relus, ils ne doivent pas occulter la richesse d'une œuvre vaste, d'un journalisme de combat qui ne voulait rester étranger à rien de ce qui menaçait la dignité de l'homme. Ce «Qui suis-je?» George Orwell permet de décou- vrir la vie et l’œuvre d'un infatigable défenseur de ce qu'il nomma la common decency (notre «bon sens») face à la bureaucratie, aux machines, aux puissants. Maître de courage et de lucidité, resté fidèle, toute sa vie, à ce qu'il pensait être la vérité, Orwell meurt prématurément, à Londres, le 21 janvier 1950.« Le totalitarisme a aboli la liberté de pensée jusqu'à un point jamais connu à aucune époque antérieure. [...] L’État totalitaire s'efforce à tout prix de contrôler les pensées et les émotions de ses sujets au moins aussi complètement qu'il contrôle leurs actions. » "
Les éditions Le passager clandestin viennent de publier, dans leur collection "Les précurseurs de la décroissance", un essai de Stéphane Lemenorel intitulé George Orwell ou la vie ordinaire. L'auteur est poète et ancien professeur de philosophie.
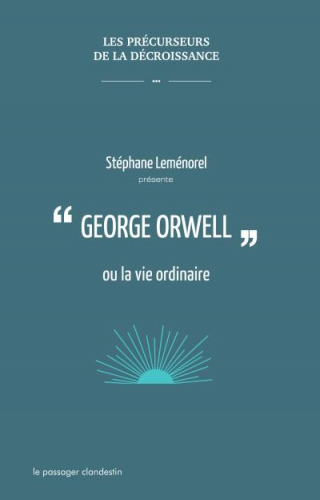
" Outre 1984, roman auquel on réduit souvent son œuvre et sa pensée, George Orwell est aussi l'auteur d'une riche œuvre critique qui, de chroniques en essais, décortique les mécanismes de la domination, s'inquiète des ravages de l'industrialisation du monde et prend la défense de la vie ordinaire de l'homme de la rue, dans laquelle il voit la possibilité d'une résistance. Inclassable trublion pour les uns, socialiste suspect pour les autres, hérétique pour tous, George Orwell ne transige pas avec les faits pour obtenir la reconnaissance intellectuelle. Aussi l'homme et son œuvre, qui gênaient tant de son vivant, ne cessent-ils d'embarrasser depuis sa disparition en 1950. "
Nous reproduisons ci-dessous un texte de Bertrand Garandeau, cueilli sur Philitt et consacré à la proximité entre la common decency chère à Orwell et à Michéa et l'éthique des Anciens. On notera que le site Philitt publie désormais une revue qu'il est possible de se procurer en ligne : revue Philitt
De la proximité entre common decency et éthique des Anciens
Les défenseurs du relativisme moral opposent à toute contestation, au nom d’un principe de tolérance dévoyé, l’épouvantail d’un totalitarisme religieux et puritain. Des alternatives à ces deux frères ennemis existent pourtant, que ce soit dans le monde antique ou dans un certain socialisme.
La privatisation de la morale est au fondement de la pensée libérale. Pour éviter les guerres entre protagonistes se réclamant du Bien et de la Vérité, chacun doit être libre d’avoir sa propre définition de la « vie bonne ». Par conséquent, le droit libéral ne doit avoir recours à aucun jugement de valeur ni à une quelconque morale commune. La cohésion d’une telle société repose alors uniquement sur la seule valeur commune non morale acceptable, définie par Voltaire en ces termes : « quand il s’agit d’argent, tout le monde est de la même religion. »
Rejeter cette logique libérale et son anthropologie légaliste, marchande et individualiste sans prôner le retour du Bien judéo-chrétien, c’est l’objet du socialisme orwellien. Ce socialisme repose sur l’idée de « common decency » ou « décence ordinaire ». Ici, point de relativisme, mais point non plus de Bien ni de Mal absolus et abstraits. La justice ne repose ni sur une Vérité divine unique ni sur une mécanique légaliste amorale, bien plutôt sur les idées de décence et d’indécence, de bien et de mauvais, de juste et d’injuste, oppositions dont la faculté de distinction est considérée comme un penchant naturel de l’homme.
Exégète d’Orwell, Jean-Claude Michéa insiste sur la distinction entre cette décence ordinaire et ce qu’il nomme les « Idéologies du Bien » et leurs « constructions moralisatrices et puritaines » : « il est nécessaire de distinguer la common decency et ce que j’ai appelé par ailleurs une idéologie morale (ou si l’on préfère une idéologie du Bien). Sous ce dernier terme, je désigne un type particulier de catéchisme dont les commandements aliénants, d’une part n’ont de sens qu’à l’intérieur d’une métaphysique donnée (qu’elle soit d’origine religieuse, politique ou autre) et, de l’autre, conduisent les fidèles à adopter des comportements mécaniques dont ils n’imaginent même pas qu’ils puissent susciter le moindre débat intérieur » (Le Complexe d’Orphée).
L’opposition dialectique entre ces idéologies du Bien et le relativisme libéral rend toute lutte contre le second particulièrement délicate. Le caractère absolu et implacable du Bien métaphysique sert en effet de repoussoir à tout adversaire de la logique libérale. Face à l’intransigeance de l’idéologue du Bien, la solution du libéral est simple, la notion même de « bien » n’existe pas, chacun est libre de vivre comme il l’entend tant qu’il ne nuit pas à autrui. Toute tentative de restauration d’une quelconque morale commune est alors perçue comme une volonté de ressusciter une idéologie du Bien et le risque de violence qu’elle implique.
La sagesse du monde antique préchrétien
Dans son double rejet des idéologies du Bien et de l’amoralisme libéral, le socialisme orwellien défendu par Michéa renoue avec une certaine vision antique du Bien et du Mal. La notion de décence peut en effet être rapprochée de la condamnation grecque de la démesure et de l’excès, l’hybris, qui ne repose pas sur la notion de Bien ou de Mal. En effet, point de Bien métaphysique dans le monde préchrétien. Pourtant, tout ne se vaut pas pour les Grecs. Certains actes sont nobles, bons, beaux et fondent l’idéal du kalos kagathos. D’autres actes sont vils, mauvais, laids et sont condamnables en tant que tels. Cette sagesse morale est celle des fables du grec Ésope reprise plus tard par La Fontaine. Les « morales » de ces histoires ne s’inscrivent pas dans l’idée du péché judéo-chrétien. Pourtant la mégalomanie du Corbeau face au Renard et la paresse de la Cigale face à la Fourmi sont sévèrement dénoncées et moquées.
De même l’éthique des Romains s’appuyait sur des valeurs comme la pietas et la gravitas qui diffèrent des vertus métaphysiques chrétiennes. La première signifie le respect des anciens et des traditions. La seconde est synonyme de retenue mais est exempte de tout puritanisme religieux car l’idée de péché lui est étrangère. On retrouve donc dans la pietas et la gravitas des notions d’enracinement et de dignité proches de la décence ordinaire qu’Orwell rencontre chez les classes laborieuses.
Le rapport d’Orwell à la religion nous éclaire également sur cette convergence. L’auteur de 1984 mais également de De droite ou de gauche c’est mon pays est profondément attaché à sa culture nationale anglicane. Orwell affirmait d’ailleurs n’avoir aucun grief contre la religion elle-même mais uniquement contre l’idée de vie après la mort. Une telle conception de la religion comme fait social, dépouillée de l’idée de salut, rappelle les religions des Anciens. Ces dernières organisaient et rythmaient la vie de la cité en conférant un cadre sacré aux gestes de la vie quotidienne ou aux événements naturels. Ces religions ne reposaient pas sur des « révélations », c’est-à-dire des commandements divins indiquant formellement le Bien et le Mal, et dont seul le respect permet de sauver son âme et d’accéder à la vie éternelle.
Cette vision du monde antique ne rejette cependant pas toute universalité, certains comportements comme le mensonge ou la lâcheté sont ainsi perçus négativement dans toutes les sociétés traditionnelles. Cependant, les disparités parfois conséquentes de mœurs peuvent exister, sans qu’un peuple donné se fixe pour objectif d’aller châtier son voisin aux mœurs différentes. Pour autant, un peuple n’est pas tenu de renoncer à sa propre subjectivité. Un comportement toléré chez autrui peut alors être blâmé au sein d’une société. Bien que les lois soient nécessaires, ce sont en effet les mœurs qui constituent le socle de la cité antique. Isocrate explicite ainsi cette idée : « les bons politiques doivent, non pas remplir les portiques de textes écrits, mais maintenir la justice dans les âmes : ce n’est pas par les décrets mais par les mœurs que les cités sont bien réglées. »
La banalité du bien
Ce rejet d’un monde manichéen qui serait le théâtre d’une lutte entre le Bien et le Mal, implique également un refus de la vertu héroïque idéalisée. À cette vision du Bien qui résiste et lutte contre le Mal ambiant, Michéa oppose les notions de « banalité du bien et de banalité du mal » qu’il reprend au philosophe du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en sciences sociales) Michel Terestchenko. Orwell lui même met en garde contre tout idéalisme moral : « les saints devraient toujours être présumés coupables, tant qu’ils n’ont pas fait preuve de leur innocence » (Reflexions on Ghandi). Or on retrouve aisément ces banalités du bien et du mal chez les dieux et les héros du monde antique qui ne sont pas toujours érigés en modèles de vertus, sans toutefois que leur qualité de dieux ou de héros ne légitiment leurs vices.
Qu’il se rattache à la décence ordinaire orwellienne ou aux valeurs païennes antiques, ce « bien banal » s’est historiquement distingué par sa capacité à rester accessibles aux classes sociales les plus humbles. L’Église dominatrice qualifia de paganisme (du latin paganus : paysan) les mœurs des populations rurales réticentes à délaisser les dieux de leurs ancêtres et la nature sacrée pour le Dieu unique et sa morale révélée. De même, Michéa fait remarquer à propos du respect de la décence ordinaire qu’elle est davantage présente dans les classes populaires, tandis qu’elle se fragilise au contact de l’argent et du pouvoir dans les classes dominantes. Idéologies du Bien et relativisme libéral sont au contraire historiquement liés aux structures de pouvoir et à leurs élites qui se révoltent contre les conservatismes et les traditions populaires.
Bertrand Garandeau (Philitt, 2 avril 2016)
Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Kévin Victoire cueilli sur le site du Comptoir et consacré au socialisme populaire de Georges Orwell et de Simone Weil...
Avec Simone Weil et George Orwell, pour un socialisme vraiment populaire
L’écrivain britannique George Orwell et la philosophe française Simone Weil connaissent tous deux depuis quelques années un regain d’intérêt. Alors que la gauche, notamment la gauche radicale — c’est-à-dire celle qui se donne pour objectif de trouver une alternative au capitalisme —, est en crise idéologique et perd peu à peu les classes populaires, on pense qu’elle aurait tout intérêt à se pencher sur ces deux penseurs révolutionnaires.
Comme le note la philosophe Alice Holt dans un article publié en France dans la revue Esprit[i], « les convergences qui rapprochent Orwell et Weil sont frappantes, pas seulement en ce qui concerne leurs biographies hors du commun, mais aussi en ce qui concerne leurs conceptions politiques dissidentes, fondées sur une expérience directe et caractérisées par la reprise et le remodelage de thèmes traditionnellement de droite, ou encore en ce qui concerne leur critique originale des régimes totalitaires ». Les similitudes en effet sont nombreuses entre les deux contemporains, qui ne se sont jamais croisés et probablement jamais lus, mais qui sont aujourd’hui enterrés à quelques kilomètres l’un de l’autre, dans le sud de l’Angleterre.
Sur le plan biographique d’abord, tous deux ont fréquenté des écoles très prestigieuses — Henri IV, puis l’École normale supérieure pour Weil, le Collège d’Eton pour Orwell — et en ont gardé de mauvais souvenirs ; sont issus de la classe moyenne éduquée — Orwell parle de « basse classe moyenne supérieure »— ; ont eu à cœur de partager les conditions de vie des prolétaires ; ont participé à la guerre d’Espagne — chez les anarcho-syndicalistes de la CNT pour la Française, chez les marxistes non-staliniens du POUM pour l’Anglais[ii] — ; ont contracté la tuberculose — bien que la privation intentionnelle de nourriture semble être la véritable cause de la mort de la philosophe. Mais la proximité est encore plus forte sur le terrain idéologique entre Orwell, socialiste difficilement classable — et parfois qualifié d’« anarchiste conservateur » qui n’hésite jamais à citer des écrivains libéraux ou conservateurs sans pour autant partager leurs conceptions politiques[iii] —, et Simone Weil, anarchiste chrétienne et mystique, capable d’exprimer sa « vive admiration » à l’écrivain monarchiste Georges Bernanos. Pour les libertaires des éditions de l’Échappée, les deux révolutionnaires préfigurent « à la fois la dénonciation de l’idéologie du progrès, l’attachement romantique à l’épaisseur historique, la critique totalisante du capitalisme sous tous ses aspects, la méfiance envers la technoscience »[iv]. Sans oublier que ces deux sont en premier lieu les défenseurs d’un socialisme original, qui accorde une importance particulière aux classes populaires et à leurs traditions.
Aimer, connaître, devenir l’oppressé
Selon le philosophe Bruce Bégout, « chaque ligne écrite par Orwell peut donc être lue comme une apologie des gens ordinaires ».[v] L’attachement politique d’Orwell aux « gens ordinaires » fait écho à leur définition en tant qu’ensemble majoritaire de personnes menant leur vie sans se préoccuper de leur position sociale ou du pouvoir — contrairement aux « gens totalitaires ». Le socialisme est la version ultime de l’abolition de « toute forme de domination de l’homme par l’homme ». Il doit donc être radicalement démocratique et se présenter comme « une ligue des opprimés contre les oppresseurs » qui rassemble « tous ceux qui courbent l’échine devant un patron ou frissonnent à l’idée du prochain loyer à payer » (Le Quai de Wigan, The Road to Wigan Pier). Une coalition des classes populaires qui irait des prolétaires aux classes moyennes — des petits boutiquiers aux fonctionnaires — en passant par les paysans. Pour aboutir, le socialisme doit s’appuyer sur des mots d’ordre simples et rassembleurs, conformes au bon sens des gens ordinaires — comme la nationalisation des terres, des mines, des chemins de fer, des banques et des grandes industries, de la limitation des revenus sur une échelle de un à dix, ou encore de la démocratisation de l’éducation.
Parallèlement, Simone Weil considère, dans Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale — seul ouvrage publié de son vivant, en 1934 — que l’objectif du socialisme doit être la réalisation de la « démocratie ouvrière » et « l’abolition de l’oppression sociale ». Celle qui était surnommée « la Vierge rouge » — comme Louise Michel avant elle — étend son analyse de l’aliénation des travailleurs par la société industrielle à la classe paysanne. Ces travailleurs ont aussi été réduits à la « même condition misérable » que celle des prolétaires : ils sont tout autant soumis à l’échange marchand, en tant qu’ »ils ne peuvent atteindre la plupart des choses qu’ils consomment que par l’intermédiaire de la société et contre de l’argent ». Ne pas saisir dans sa propre chair le poids de cette aliénation est, pour la philosophe, la raison de l’échec des marxistes et de leur « socialisme scientifique », qui a mené à l’appropriation du mouvement ouvrier par une caste d’intellectuels.
Pour Simone Weil, les disciples de Karl Marx — qui « rend admirablement compte des mécanismes de l’oppression capitaliste » —, et notamment les léninistes, n’ont pas compris l’oppression que supportent les ouvriers en usine car « tant qu’on ne s’est pas mis du côté des opprimés pour sentir avec eux, on ne peut pas se rendre compte ». Et la philosophe de regretter : « Quand je pense que les grands chefs bolcheviks prétendaient créer une classe ouvrière libre et qu’aucun d’eux — Trotski sûrement pas, Lénine je ne crois pas non plus — n’avait sans doute mis le pied dans une usine et par suite n’avait la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté des ouvriers, la politique m’apparaît comme une sinistre rigolade. »
C’est pourquoi elle choisit d’abandonner provisoirement sa carrière d’enseignante en 1934 et 1935, pour devenir ouvrière chez Alsthom (actuel Alstom), avant de travailler à la chaîne aux établissements JJ Carnaud et Forges de Basse-Indre, puis chez Renault à Boulogne-Billancourt. Elle note ses impressions dans son Journal d’usine — publié aujourd’hui sous le titre La condition ouvrière — et conclut de ses expériences, à rebours de l’orthodoxie socialiste, que « la complète subordination de l’ouvrier à l’entreprise et à ceux qui la dirigent repose sur la structure de l’usine et non sur le régime de la propriété » (Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale).
Similairement, George Orwell déplore, dans Le Quai de Wigan, que « le petit-bourgeois inscrit au Parti travailliste indépendant et le barbu buveur de jus de fruits [soient] tous deux pour une société sans classe, tant qu’il leur est loisible d’observer le prolétariat par le petit bout de la lorgnette ». Il poursuit : « Offrez-leur l’occasion d’un contact réel avec le prolétariat […] et vous les verrez se retrancher dans le snobisme de classe moyenne le plus conventionnel. » Comme Weil, le Britannique se rapproche des opprimés, notamment en partageant plusieurs fois les conditions de vie des vagabonds. Dans Dans la dèche à Paris et à Londres (Down and Out in London and Paris), roman publié en 1933 qui s’inspire de ces expériences, il explique qu’il voulait « [s]’ immerger, descendre complètement parmi les opprimés, être l’un des leurs, dans leur camp contre les tyrans. » Par la suite, il se plonge dans l’univers des mineurs des régions industrielles, ce qui lui inspirera la première partie du Quai de Wigan et surtout le convertira définitivement au socialisme.
Ces expériences ont très fortement influencé les deux auteurs. Alice Holt note d’ailleurs à ce propos que « c’est parce qu’Orwell et Weil ont tous deux fait l’expérience de la souffrance psychologique et physique qu’occasionne la pauvreté, qu’ils mirent autant l’accent sur le potentiel destructeur de l’humiliation, et la nécessité de préserver la dignité des plus pauvres ».
Weil et Orwell : des socialistes conservateurs ?
Le contact de Weil et d’Orwell avec le monde ouvrier leur a permis de comprendre la souffrance des travailleurs et l’impératif subséquent à préserver « ce qu’il leur reste ». C’est ainsi qu’ils ont tous les deux évolué politiquement vers une forme de conservatisme (ou à du moins à ce qui lui est apparenté aujourd’hui), par respect pour la culture populaire et pour la défense de la dignité des opprimés. Tout en étant profondément révolutionnaires, ils considèrent que la défense des traditions et de la mémoire populaire est un devoir formel. Ainsi, Simone Weil explique, notamment dans L’Enracinement, que : « l’amour du passé n’a rien à voir avec une orientation politique réactionnaire. Comme toutes les activités humaines, la révolution puise toute sa sève dans une tradition. » La common decency (traduit par « décence commune » ou « décence ordinaire ») d’Orwell et l’enracinement de Weil forment le pivot de leur philosophie.
Bruce Bégout, qui a consacré un ouvrage au sujet (De la décence ordinaire), définit la common decency comme « la faculté instinctive de percevoir le bien et le mal ». « Plus qu’une simple perception, car elle est réellement affectée par le bien et le mal », elle correspond « à un sentiment spontané de bonté qui est, à la fois, la capacité affective de ressentir dans sa chair le juste et l’injuste et une inclination naturelle à faire le bien ». D’après Orwell, ces vertus, qu’il certifie avoir rencontrées au contact des « gens ordinaires », proviennent de la pratique quotidienne de l’entraide, de la confiance mutuelle et des liens sociaux minimaux mais fondamentaux. À l’inverse, elles seraient moins présentes chez les élites, notamment chez les intellectuels, à cause de la pratique du pouvoir et de la domination.
Pour Simone Weil, l’enracinement — titre de son ouvrage testament, sorte de réponse aux Déracinés du nationaliste d’extrême droite Maurice Barrès – est « le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine ». Il est le processus grâce auquel les hommes s’intègrent à une communauté par le biais « [du] lieu, la naissance, la profession, l’entourage ». Pour la Française, « un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. Chaque être humain a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie. » Cet enracinement est la base d’obligations mutuelles entre les hommes – L’Enracinement a d’ailleurs pour sous-titre « prélude d’une déclaration des devoirs envers l’être humain ».
Ainsi, Weil estime que « le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même ». Ce mécanisme passe notamment par la destruction du passé, déplorant que « la destruction du passé [soit] peut-être le plus grand crime. Aujourd’hui, la conservation du peu qui reste devrait devenir presque une idée fixe ». C’est parce que le capitalisme déracine les classes populaires, comme le colonialisme déracine les indigènes, qu’il faut lutter contre ce système. Si le mot « enracinement » est absent de l’œuvre de George Orwell, il est probable qu’il y aurait largement adhéré. Le philosophe Jean-Claude Michéa relève ainsi que chez l’Anglais, « le désir d’être libre ne procède pas de l’insatisfaction ou du ressentiment, mais d’abord de la capacité d’affirmer et d’aimer, c’est-à-dire de s’attacher à des êtres, à des lieux, à des objets, à des manières de vivre. »[vi]
L’enracinement, la common decency et l’attachement aux lieux, traditions et à la communauté qui en émane, conduisent Weil et Orwell vers un patriotisme socialiste, qui s’exprimera dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. La philosophe explique alors dans L’Enracinement qu’« il serait désastreux de [s]e déclarer contraire au patriotisme. Dans la détresse, le désarroi, la solitude, le déracinement où se trouvent les Français, toutes les fidélités, tous les attachements sont à conserver comme des trésors trop rares et infiniment précieux, à arroser comme des plantes malades. » Quant au Britannique, il lie patriotisme et socialisme dans Le Lion et la licorne : socialisme et génie anglais publié en 1940 – que l’un de ses principaux biographes, Simon Leys, considère comme « son manifeste politique le plus complet et le plus explicite »[vii] – afin de théoriser un « patriotisme révolutionnaire« [viii]. Orwell explique : « La théorie selon laquelle « les prolétaires n’ont pas de patrie » […] finit toujours par être absurde dans la pratique. » Dans l’article De droite ou de gauche, c’est mon pays, il ajoute : « Aucun révolutionnaire authentique n’a jamais été internationaliste. »
Pourtant, Orwell et Weil resteront tous deux fidèles à la tradition socialiste et à la solidarité internationale sans jamais tomber dans un nationalisme maurrassien. Orwell, que son service pour l’Empire britannique en Birmanie a converti à l’anti-colonialisme, considère dans ses Notes sur le nationalisme que le patriotisme est un « attachement à un mode de vie particulier que l’on n’a […] pas envie d’imposer à d’autres peuples », tandis que le nationalisme est « indissociable de la soif de pouvoir ». De son côté, Simone Weil écrit à Bernanos à propos du Traité de Versailles : « Les humiliations infligées par mon pays me sont plus douloureuses que celles qu’il peut subir. » Mais c’est surtout leur engagement en Espagne, motivé par l’envie de combattre le fascisme et de défendre le socialisme, qui prouve que la solidarité internationale n’est pas un simple concept pour eux, mais bien une réalité. À l’image de leur patriotisme, leur conservatisme populaire ne s’oppose jamais à leur socialisme, il en est au contraire un fondement.
Un socialisme populaire et antibureaucratique
Pour Orwell et Weil, le socialisme ne doit pas être l’émancipation forcée des prolétaires, mais leur affirmation, à travers leur enracinement.En ce sens, ils peuvent être tous deux rattachés à la famille du socialisme libertaire, qui s’oppose au socialisme autoritaire depuis l’exclusion de Bakounine et ses partisans de la Ire Internationale, en 1872. À rebours des révolutionnaires, notamment marxistes-léninistes, qui veulent créer un « homme nouveau », les deux auteurs prônent un socialisme qui prend racine dans les valeurs défendues par les classes populaires. Ainsi, Simone Weil exprime dans L’Enracinement son souhait d’une révolution qui « consiste à transformer la société de manière que les ouvriers puissent y avoir des racines » , et s’oppose à ceux qui entendent avec le même mot « étendre à toute la société la maladie du déracinement qui a été infligée aux ouvriers ».
À l’identique, le romancier anglais estime que « l’ouvrier ordinaire […] est plus purement socialiste qu’un marxiste orthodoxe, parce qu’il sait ce dont l’autre ne parvient pas à se souvenir, à savoir que socialisme est justice et simple bonté » (Le Quai de Wigan). Il déplore : « Les petites gens ont eu à subir depuis si longtemps les injustices qu’elles éprouvent une aversion quasi instinctive pour toute domination de l’homme sur l’homme. » À ce titre, le socialisme doit reposer sur la common decency, qui constitue chez lui d’après Bruce Bégout « une base anthropologique sur laquelle s’édifie la vie sociale ». Pour ce dernier, la « décence ordinaire est politiquement anarchiste : elle inclut en elle la critique de tout pouvoir constitué ». La confiance d’Orwell dans les gens ordinaires s’accompagne d’une défiance à l’égard des intellectuels qui souhaiteraient prendre la direction du mouvement socialiste. Car selon lui, « les intellectuels sont portés au totalitarisme bien plus que les gens ordinaires ». Une critique du pouvoir constitué également très présente chez Simone Weil. Fidèle à la tradition anarchiste, l’ex-combattante de la CNT invite dans La pesanteur et la grâce à « considérer toujours les hommes au pouvoir comme des choses dangereuses ».
Cette méfiance à l’égard du pouvoir les conduit à critiquer la bureaucratie et la centralisation, incarnées par l’URSS. Pour George Orwell, « rien n’a plus contribué à corrompre l’idéal originel du socialisme que cette croyance que la Russie serait un pays socialiste ». L’écrivain arrive même à la conclusion que « la destruction du mythe soviétique est essentielle […] pour relancer le mouvement socialiste ». Outre la dissolution des liens communautaires induit par le totalitarisme, qui a pour caractéristique le contrôle de l’histoire – et donc du passé –, George Orwell déplore « les perversions auxquelles sont sujettes les économies centralisées » et la prise de pouvoir d’une « nouvelle aristocratie ». Dans son célèbre roman 1984, il décrit celle-ci comme « composée pour la plus grande part de bureaucrates, de scientifiques, de techniciens, [et] d’experts », issus pour la plupart « de la classe moyenne salariée et des rangs plus élevés de la classe ouvrière ». Pour Simone Weil, qui considère qu’un État centralisé a nécessairement pour but de concentrer toujours plus de pouvoir entre ses mains, l’URSS possède « une structure sociale définie par la dictature d’une caste bureaucratique ». Sur la critique de la centralisation, elle va même plus loin et se distingue radicalement du marxisme, auquel elle a appartenu dans sa jeunesse. Alors que pour Lénine et les bolcheviks, le parti communiste est le véritable créateur de la lutte des classes et l’instrument qui doit permettre au prolétariat de conquérir le pouvoir afin de libérer la société, Simone Weil propose de détruire toutes organisations partisanes (Notes sur la suppression générale des partis politiques). La Française voit dans le parti « une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres », qui a pour fin « sa propre croissance et cela sans aucune limite » et estime donc que « tout parti est totalitaire en germe et en aspiration ».
Les pensées de ces deux auteurs difficilement classables convergent ainsi sur des points essentiels – dont certains n’ont pu être approfondis ici, comme leur critique du Progrès ou de la technique –, parfois ignorés par les socialistes, et terriblement actuels. Selon Albert Camus, à qui nous devons la publication posthume de L’Enracinement, « il paraît impossible d’imaginer pour l’Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Weil a définies ». Alors que la gauche n’a jamais semblé aussi éloignée du peuple qu’aujourd’hui, nous pourrions, pour commencer, dire qu’il paraît impossible d’imaginer une renaissance du mouvement socialiste qui se passerait des écrits de Simone Weil et de George Orwell. À travers leur œuvre, ces deux contemporains se sont efforcés de nous rappeler l’importance pour un révolutionnaire d’être en accord avec les aspirations des classes populaires, tout en nous mettant en garde contre certaines dérives, telles que l’autoritarisme.
Kévin Victoire (Le Comptoir, 22 juin 2015)
Notes :
[i] Holt Alice et Zoulim Clarisse, « À la recherche du socialisme démocratique » La pensée politique de George Orwell et de Simone Weil, Esprit, 2012/8 Août. En ligne ici (payant)
[ii] Il est intéressant de noter que George Orwell écrit dans Hommage à la Catalogne (Homage to Catalonia, 1938) : « Si je n’avais tenu compte que de mes préférences personnelles, j’eusse choisi de rejoindre les anarchistes. »
[iii] Pour George Orwell, « le péché mortel c’est de dire “X est un ennemi politique, donc c’est un mauvais écrivain” ».
[iv] Cédric Biagini, Guillaume Carnino et Patrick Marcolini, Radicalité : 20 penseurs vraiment critiques, L’Échappée, 2013
[v] Bruce Bégout, De la décence ordinaire. Court essai sur une idée fondamentale de la pensée fondamentale de George Orwell, Allia, 2008
[vi] Jean-Claude Michéa, Orwell, anarchiste tory, Castelneau-Le-Lez, Éditions Climats, 1995
[vii] Simon Leys, Orwell ou l’horreur de la politique, Hermann, 1984 ; Plon, 2006
[viii] Il oppose cependant ce « patriotisme révolutionnaire » au conservatisme. Il écrit notamment dans Le lion et la licorne : « Le patriotisme n’a rien à voir avec le conservatisme. Bien au contraire, il s’y oppose, puisqu’il est essentiellement une fidélité à une réalité sans cesse changeante et que l’on sent pourtant mystiquement identique à elle-même. »